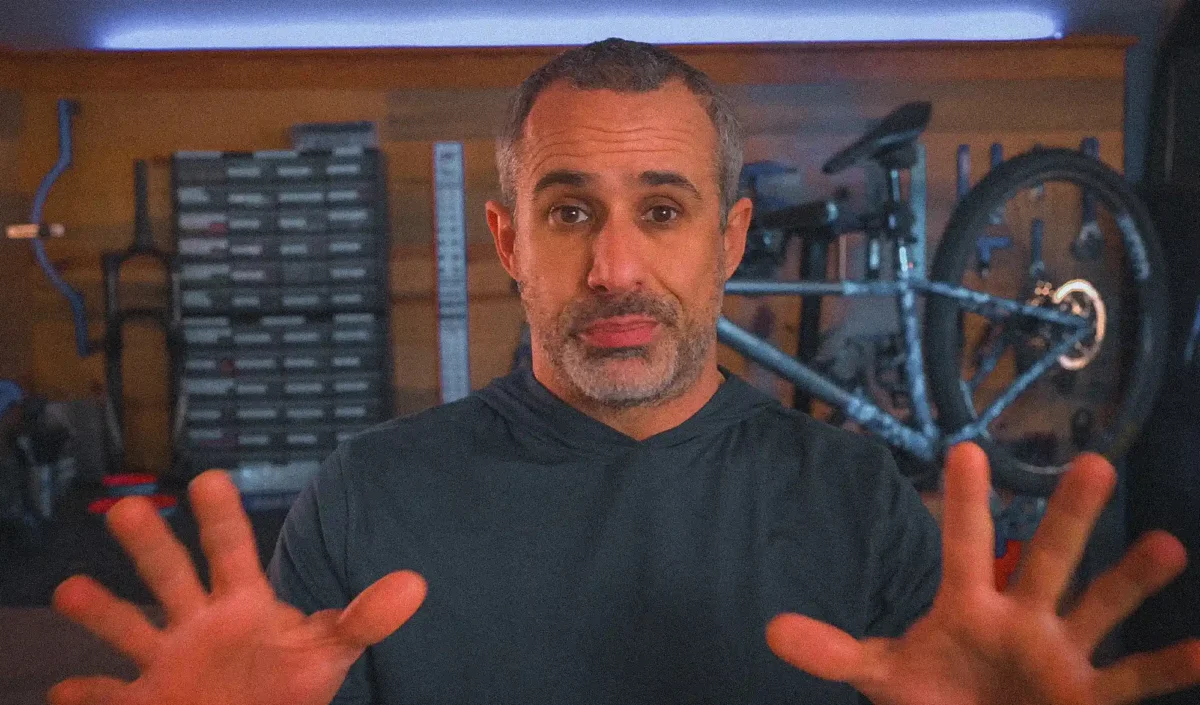À Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, une croix chrétienne posée sans autorisation au sommet du mont de la Plane vient de déclencher une tempête de menaces et d’insultes contre le maire de la commune, à l’origine de son retrait. L’élu est intervenu en toute légalité… mais en recourant à un hélico. De quoi faire hurler les défenseurs de l’environnement, et surtout raviver le débat sur la présence de ces croix et vierges qui peuplent nos montagnes depuis des siècles. En France, comme en Suisse, le débat fait rage. Et ne semble pas prêt de s’apaiser.
La séquence qui enflamme depuis quelques jours les esprits a démarré à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. Une croix, bricolée par des randonneurs “pour restaurer”, selon eux, un ancien calvaire encore en place, a été installée sans autorisation sur un terrain communal au mont de la Plane, à 2 545 mètres d’altitude. Saisie par la préfecture, la mairie a fait retirer cette croix le 8 octobre par hélicoptère, en application de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L’ancienne croix, “l’historique”, est toujours en place et n’a pas été touchée.
“J’ai simplement appliqué la loi”, explique l’élu, violemment attaqué sur deux fronts. Celui de l’héliportage, qui en a fait tousser plus d’un — tant pour la démesure des moyens employés et leur coût financier que pour leur impact environnemental — et celui du respect de la laïcité sur l’espace public. Les plus virulents dans cette affaire se trouvant du côté de ceux qui s’insurgent contre le retrait lui-même. Or si la question de l’hélicoptère est condamnable, celle de l’enlèvement repose sur un argument que l’on peut entendre. L’illégalité invoquée ici ne portait pas sur la croix historique, régulièrement entretenue comme l’a souligné le maire, et qui n’a pas été touchée, mais sur la deuxième, récente et non autorisée sur cet espace public.
La France n’en est pas à sa première querelle de croix. La Corse est actuellement agitée par une affaire similaire. Quelque peu différente, mais hautement inflammable. En cause ici aussi, un calvaire — un symbole fort dans l’île. Pas de sommet en cause : il est installée depuis 2022 à l’entrée du village de Quasquara (Corse-du-Sud). En bord de route, mais dans un espace public. Aussi le tribunal administratif de Bastia a-t-il demandé son retrait le 10 octobre, faisant fi du refus du maire. L’onde de choc a été immédiate : banderoles dans les lycées, pétition massive, réactions de tout l’arc politique insulaire. L’Église et la préfecture ont dû appeler à l’apaisement et au dialogue.
Plus loin dans le temps, il faut remonter à 2011, à Publier (en Haute-Savoie, toujours) pour voir la justice intervenir sur le terrain miné des symboles religieux. Cette année-là, c’est l’érection d’une statue de la Vierge, aux frais de la commune, qui a été jugée contraire à la laïcité. Installée au-dessus du village, elle était censée donner un point de repère bienveillant, selon le maire. Sous la pression, il a reconnu son erreur et finalement choisi de vendre la statue à une association pour la “privatiser” et mettre fin à la polémique.
Nos voisins suisses connaissent les mêmes tensions. En 2010, un guide fribourgeois, bientôt surnommé le “coupeur de croix”, a scié ou tenté de scier des croix sommitales pour “libérer la montagne des symboles religieux”. Il sera condamné en 2012. Mais surtout, le débat qu’il a suscité a montré combien la montagne cristallise des représentations : lieu de liberté, de nature “pure”, de traditions, et aussi de patrimoine, comme l’analysait en 2014 le chercheur Mathieu Petite.
Au cœur de cette affaire qui a agité la Suisse pendant des semaines, le média valaisan Rhône FM rappelait que les croix de sommet, souvent récentes, étaient nées avec les débuts de l’alpinisme au XIXe siècle. A la fois marques de conquête et signes religieux, elles ont été tour à tour aimées, photographiées… ou vandalisées.
Alors, pourquoi tant de passion ? Parce que ces objets fonctionnent comme des totems : ils synthétisent un faisceau d’attachements. Quand certains y voient la trace de la mémoire locale, un repère d’itinéraire, voire une “présence” protectrice, d’autres les rejettent et refusent tout marquage confessionnel de l’espace commun.
L’objet fait débat parce qu’il “fait” du social. Il met à nu des visions concurrentes de la montagne : sanctuaire de la nature, ou paysage habité, héritier d’un catholicisme alpin. Espace neutre, ou lieu où s’affiche un récit collectif, interroge le chercheur.
Plus simplement, et pour apaiser les esprits, ne confondons pas signe religieux et patrimoine de montagne. On peut, simultanément, faire respecter la loi et considérer qu’une partie des croix de cimes ou statues anciennes — symboles chéris depuis toujours par les montagnards comme par les marins — relèvent du patrimoine commun et représentent pour beaucoup des repères apaisants sur des sites où le danger n’est jamais très loin.
C’est exactement l’esprit des guides chamoniards Guillaume Pierrel et Lucien Boucansaud qui, en dix jours, ont enchaîné les sept “Madones” du massif du Mont-Blanc, sans prosélytisme : “Nous ne sommes pas chrétiens pratiquants… mais ces madones sont belles, elles transforment la montagne en sanctuaire”, expliquaient-ils Leur aventure est devenue un film, La Madone, programmé cet automne au FIFAV La Rochelle. Le regarder donne une autre perspective à un débat qui, pour l’essentiel, n’a pas lieu d’être.