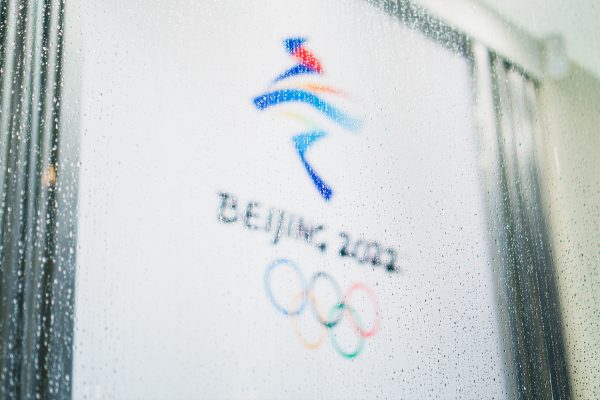Des moissons de médailles, c’est ce que Pékin entend retirer de ces Jeux d’hiver officiellement lancés aujourd’hui. Car si la Chine n’a plus rien à prouver aux JO d’été – à Tokyo elle s’est imposée comme le 2e pays le plus médaillé (88 breloques dont 38 en or)… juste derrière les Etats-Unis (113 dont 39 en or) – elle a encore fort à faire sur les pistes. Un secteur, et un marché, sur lequel elle mise gros. Forte des résultats de stars du ski acrobatique telles que Eileen Gu et Xu Mengtao, ou encore de la snowboardeuse Car Xuetong, toutes présentes à Pékin cette année, c’est à marche forcée et à grand renfort de publicité que le Parti a entrepris ces dernières années de convertir le peuple chinois aux plaisirs de la glisse, comme le constatait dès 2019 notre journaliste Tim Neville, parti enquêter sur le terrain. À l’approche de la ville, on perçoit déjà quelques indices de la folie qui se prépare. “FAISONS DE CHONGLI UN DISTRICT DE CIVILITÉ ET POLITESSE !” hurle une bâche accrochée à la clôture d’un chantier, laissant entrevoir une enfilade de sculptures flambant neuves de skieurs tout schuss. Sur l’autoroute qui nous amène de Pékin, je distingue également un grand panneau montrant l’empreinte fraîche de skis sur une piste immaculée et affirmant : “VOS TRACES PERDURENT LONGTEMPS APRÈS VOTRE PASSAGE !”. Depuis plusieurs dizaines de mois, le district de Chongli travaille son image en prévision des Jeux olympiques d’hiver de 2022 : hors de question de perdre la face sous les projecteurs du monde entier. Cet espèce d’avant-poste mêlant mineurs, paysans et bureaucrates locaux est en pleine expansion depuis qu’il a été décidé qu’il accueillerait un bon nombre d’épreuves et de cérémonies de remise de médailles. Triste nouvelle pour les cochons du coin, qui ne seront plus autorisés à s’oublier dans les rues. Chongli est une vaste région montagneuse située à environ 220 kilomètres au nord-ouest de…
La suite est réservée aux abonnés
il vous suffit de créer un compte (gratuit)
- Accédez à tous les contenus d’Outside en illimité. Sans engagement.
- Votre contribution est essentielle pour maintenir une information de qualité, indépendante et vérifiée.
- Vous pouvez aussi acheter cet article pour 1€